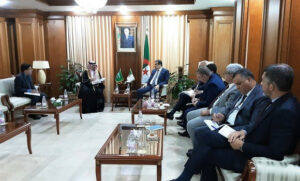Les droits de l’Homme, question secondaire ou fondamentale?

Par Sadek Hadjeres
La tragédie algérienne va-t-elle connaître un tournant ? Les citoyens angoissés essayent d’y voir clair dans un enchevêtrement dramatique : des actes d’une violence insensée, des négociations aux rebondissements imprévisibles, des efforts de sauvetage d’une économie sinistrée, des pressions internationales en tous sens.
Sur cette toile de fond, poser le problème des droits de l’Homme ou celui des libertés des citoyens, est-il une diversion ou une question fondamentale par rapport à la question-clef qui domine toutes les autres : comment agir pour arrêter la spirale infernale et sortir de la crise ?
Dans les affrontements en cours, les atteintes aux droits de l’Homme sont quotidiennes et massives. Une grave banalisation fait que l’opinion n’en retient le plus souvent que les plus spectaculaires ou les plus porteuses de symboles. Cheïkh Bouslimani, Abdelkader Allaoua et Youssef Fathallah n’étaient pas des combattants armés. Leurs paroles et leurs actes visaient la paix civile.
Les citoyens qui ont défilé le 29 juin dernier à Alger s’exprimaient pacifiquement. Quoi qu’on pense de leurs opinions, les bombes meurtrières sont-elles la réponse adéquate à leur démarche ? À quelle logique humaine ou divine obéit l’assassinat de ressortissants étrangers ? Les auteurs de ces crimes accepteraient-ils que cette même logique s’applique à nos compatriotes séjournant dans des pays étrangers en crise ?
La violence de la hausse des prix frappe chaque jour d’innombrables bébés et vieillards dont les organismes épuisés par la malnutrition ne peuvent supporter la maladie.
Mais comme si l’article 120 n’était pas enterré, on continue à vouloir réduire au silence les travailleurs et les syndicats qui revendiquent pour leurs enfants le droit à la vie et à la santé. Certains osent prétendre que c’est le chemin inévitable pour la modernisation économique. Des femmes à la dignité irréprochable sont insultées, mutilées, assassinées, on ne leur reconnaît pas la qualité d’être humain parce qu’elles ne sont pas habillées de telle ou telle façon, ne veulent pas abandonner leur profession utile au pays.
Jamais notre peuple n’a éprouvé autant le besoin d’être protégé par des droits civiques clairement définis et garantis. Le pire serait de banaliser la barbarie, de s’y habituer.
Il ne sert pourtant à rien de s’en ternir à l’indignation, encore moins aux lamentations médiatiques. À quoi mèneraient aussi les cris de vengeance des familles de radicaux ou modérés républicains ou islamistes foudroyées par le malheur ?
Reste le plus difficile, réfléchir sérieusement, collectivement aux solutions et aux sorties de crise, sans être des rêveurs ni accroître les divisions de clans.
Peut-être est-ce ainsi, seulement, que l’Algérie gagnera un peu de temps et n’attendra pas quinze ans d’horreur comme le Liban.
Là-bas, des groupes sociaux qui avaient sans doute des intérêts légitimes à défendre, ont cru plus efficace de le faire en s’entretuant au nom de projets de société volontaristes et hégémonistes, dans un langage politique ou religieux sacralisé. Il a bien fallu ensuite dans ce pays épuisé, harmoniser ces projets antagoniques avec les besoins de la vie courante, les aspirations profondes et communes des citoyens, les rapports de forces locaux, régionaux et internationaux, la diversité de la société et de ses rythmes d’évolution.
Il est vital, pour la survie de notre société, de prendre conscience de cette logique dangereuse qui transforme ces affrontements politiques, somme toute normaux pour le pouvoir, en course tragique à la destruction du tissu national.
Dans la propagande, chacun admet que l’Algérie est gravement malade. Dans les faits, les guérisseurs revendiquent chacun la plus grande responsabilité dans l’avenir du patient, mais ils ne sont pas d’accord sur la nature des soins à lui apporter : chacun préconise un traitement de choc, une rupture qu’il comprend à sa manière et qu’il veut réaliser immédiatement, sans préparation ni transition, seul et sans contrôle.
Le premier concerné, le peuple affaibli par les traitements successifs violents et contradictoires, pourra-t-il donner une opinion sur sa propre survie ?
Ne lui faudrait-il pas moins de chocs et plus de soins adaptés à son état pour supporter les graves opérations qu’on le somme d’engager sans délai ? Comment libérer les énergies qu’il porte en lui ? Comment prendre une saine décision au milieu de cette confusion et des intérêts inavoués ?
Tous ceux qui tiennent à ce que l’Algérie reste en vie, parviendront-ils à imposer une démarche de raison ?
Dans un climat empoisonné par les anathèmes, les procès d’intention, les manœuvres de toutes sortes, nombreux sont pourtant les citoyens qui ont vécu ou sont prêts à vivre les idéaux de l’Islam et de la démocratie d’une façon sereine et sans les opposer. Nombreux sont prêts au-delà de toute appartenance ou allégeance partisane passée ou présente, à faire de ces deux idéaux une lecture historique saine, conforme aussi bien au patriotisme de notre peuple, à son attachement à certaines valeurs respectables de notre culture et de notre société qui rejette l’injustice et l’arbitraire, qu’à l’ouverture sur des valeurs plus universelles.
Nombreux sont aussi ceux qui n’opposent pas leurs convictions modernistes à la soif ardente de justice sociale, de démocratie et de paix des jeunes déshérités, même lorsqu’elle est dévoyée par le désespoir.
C’est le cas en particulier parmi tous ceux qui ont partagé et défendu leur cause fermement, quoique de façon constructive, pendant les dures années noires où le système du parti unique les accusait de démagogie populiste et les excluait constitutionnellement de leurs droits et libertés civiques.
En cette période, la défense des droits de l’Homme expose à des pressions énormes de toutes parts.
La folie meurtrière et des exactions voudraient se perpétuer avec la justification explicite ou implicite de la loi du Talion ou du premier agresseur : modernistes et traditionalistes se retrouvant alors dans la même sentence ravageuse : « al aïnou bil aïni wal badiou adhlam » , « œil pour œil, celui qui a commencé étant le plus coupable ». La priorité est-elle aujourd’hui, dans la pratique, de répondre à la question : qui a commencé le cycle des violences ?
Chacun a son opinion sur les raisons du déploiement de la violence ouverte et massive après l’interruption du processus électoral comme sur les multiples formes de violences réelles, masquées ou potentielles avant décembre 1991. Le débat sur cette question, sil parvient à une relative sérénité, sera salutaire pour nos futures institutions.
Mais aujourd’hui, une urgence plus grande est ressentie par notre peuple. Comment sortir de ce cycle où l’ennemi le plus redoutable est devenu la montée des haines et la confusion politique qui rendent l’avenir du pays mortellement incontrôlable ?
Dans ces circonstances, la question des droits de l’Homme prend une signification politique plus grande.
Ce n’est pas seulement une question humanitaire pour chaque famille algérienne frappée ou menacée par les deuils et les angoisses ; Il est vrai que les larmes sont aussi amères pour la mère du militant islamiste assassiné à sa sortie du camp que pour celle de l’agent de la circulation, du journaliste ou du jeune appelé du service national massacrés devant leurs familles.
Cette question est souvent rabaissée au rôle d’un simple instrument de propagande pour discréditer le camp adverse. On sait fort bien que les violations des droits de l’Homme et des libertés ne sont pas reconnues de la même façon par les individus ou les groupes selon que ces derniers en sont les victimes ou les auteurs.
S’il en est ainsi, c’est parce que l’attitude envers les droits de l’Homme (individus ou collectivités) révèle de plus en plus à l’opinion jusqu’à quel point les porteurs de projets de société se conforment ou non, par leurs actes, aux valeurs morales de justice et de dignité humaine qu’ils proclament.
Mieux que des discours, elle montre à tous ce que chacun est prêt à faire s’il dispose du pouvoir.
Du même coup, cela ouvre aussi un champ de recomposition politique sur des bases plus salutaires à toute la société. Quand les uns accusent les autres de violation de ces droits et valeurs, y a-t-il meilleure preuve d’attachement à ces droits, pour tous, que d’œuvrer ensemble à dégager le pays de la spirale de la violence ?
Y aurait-il tâche plus noble que de guider ce pays vers un transition dont la fonction principale serait d’établir les règles formelles et informelles qui lui éviteront des tragédies aussi douloureuses et coûteuses ?
Mais n’est-ce pas faire preuve de naïveté que de croire à un quelconque respect des droits de l’Homme quand l’engrenage meurtrier de la violence s’est enclenché ? D’aucuns disent : comment parler de droits de l’Homme quand le droit à la vie est lui-même mis en cause ?
Il s’agit précisément de défendre ce droit à la vie comme le premier et suprême des droits de l’Homme. Sa violation est la forme extrême de privation de tous les autres droits et libertés.
La politique et l’humanisme se rejoignent quand il s’agit d’unir et de mobiliser tous les citoyens et croyants qui estiment qu’aucun être humain n’a le droit de se substituer à Dieu, à la nature ou à toute la société pour décider d’ôter la vie à un autre humain.
Nul ne peut s’octroyer le droit de juger la ferveur de la foi et des convictions intimes de ses concitoyens ou monopoliser par la violence la gestion de leurs affaires personnelles, familiales et publiques.
Le droit d’inspiration divine comme le droit d’inspiration républicaine se donne comme finalité théorique de protéger la dignité de l’être humain.
N’est-ce pas là une chance unique de coopération pour tous ceux qui invoquent sincèrement l’un ou l’autre de ces droits ou les deux à la fois ?
Ce n’est pas une tâche facile de proposer à ceux qui sont engagés dans des conflits de pouvoir et d’intérêts, des passerelles de bon sens qui renvoient à la sauvegarde des intérêts majeurs de toute la société. Mais les fondements d’une telle démarche existent dans les aspirations et les besoins profonds de la société à différents niveaux. Toute force politique qui n’en tient pas compte s’expose à voir rétrécir sa base sociale, même si dans les débuts, sa démarche étroite paraît lui apporter quelque avantage.
L’une des raisons pour lesquelles les démocrates de toutes sensibilités idéologiques (nationale, islamique, sociale ou culturelle) n’ont pas pu reconstituer un pôle politique autonome suffisamment influent et crédible dans le pays c’est que, souvent, ils ont enfermé leurs différents projets démocratiques dans des objectifs et des horizons partisans étroits. Ils les ont subordonnés au triomphe préalable de leur projet de société. Mais ces projets partisans, aussi fondés soient-ils, restent l’expression d’un groupe social ou d’opinion. Cela est tout à fait normal et légitime. Mais ils ne peuvent jouer un rôle de programme et de norme pour toute la société, ne deviennent crédibles et mobilisateurs que s’ils sont devenus à l’émanation de cette société, c’est-à-dire, le résultat de sa maturation sociale et politique de son travail, de ses luttes, de ses choix affirmés.
L’idéal est que cela se fasse dans des conditions, avec des institutions, des règles de fonctionnement et des mécanismes de décisions les plus démocratiques possible. C’est cela l’enjeu immédiat de la transition, des débats publics ou des obscures tractations actuelles.
Les courants démocratiques qui ignoreraient cet enjeu ou le sous-estimeraient, seraient exposés au risque de voir les mots d’ordre de voie pacifique, de dialogue, de consensus national pris en charge, utilisés et déformés à des fins d’intérêts étroits par les courants les moins démocratiques et les moins acquis au progrès social.
Il est temps que notre peuple dépasse le tragique dialogue de sourds et les pressions opposées dont il a fait les frais jusqu’ici.
Qu’il ne se laisse pas enfermer dans le dilemme des extrêmes suivants : dénier à l’Etat le devoir d’assurer la sécurité des personnes et des biens ou, au contraire, refuser à l’Etat le devoir d’initier des voies politiques pacifiques pour rétablir une vie constitutionnelle normale et démocratique.
Les deux volets sont inséparables dans toute démarche qui voudrait ouvrir la voie à un projet de société constructif.
Cette démarche n’est pas celle de la facilité. Elle exige la mobilisation des plus grandes ressources politiques, sociales et morales de la société, au lieu de s’en remettre à la seule loi des armes, parfois inévitable mais si fragile, si trompeuse et surtout si destructrice par elle seule.
Tous les intérêts économiques et de pouvoir, tous les courants de pensée sont acculés par les événements à se prononcer : notre pays doit-il vivre selon des règles connues et acceptées de tous, ou doit-il être livré à l’arbitraire du plus fort ou du plus riche spéculateur ?
Qui dit règle du jeu et Etat de droit dit qu’il faut définir et respecter un minimum d’intérêts communs et de discipline commune.
Doit-on considérer nos différences comme des antagonismes au nom desquels il faut continuer à s’entretuer, ou des complémentarités qu’il faut gérer ensemble (aussi difficile que cela soit) pour bâtir notre maison Algérie, car nous n’en avons pas d’autre ?
Chaque courant, aussi important soit-il dans notre société, ne détient qu’une des clefs des nombreuses serrures qui ferment la porte de notre avenir. La porte ne s’ouvrira qu’avec les clefs et la volonté de tous.
Doit-on épuiser l’Algérie par une logique qui ne laisse pas de choix aux adversaires politiques que la capitulation ou l’extermination ? N’est-il pas urgent d’amorcer une autre logique, celle de l’assainissement de la société et de l’Etat, celle de la construction et de la réforme de l’économie et des autres activités du pays ?
Pourquoi ne pas édifier la souveraineté populaire sur des mécanismes nouveaux, de façon que son expression électorale ne mette pas en danger la paix civile ?
Autrement dit, gagner la confiance des citoyens dans le système à venir, en protégeant les droits des administrés et des minorités du moment contre l’arbitraire des majorités et des pouvoirs en places ?
Il appartiendrait à l’armée et aux forces politiques représentatives de la société civile de garantir conjointement ces mécanismes, notamment l’application de lois qui permettent le fonctionnement constructif de contre-pouvoirs influents dans les institutions et la société.
Notre peuple, ses militants, ses hommes politiques de toutes les mouvances idéologiques sont-ils prêts à assumer cette démarche d’avenir ?
Dans le désastre des violences actuelles, les parties directement affrontées se jettent à la face l’accusation de totalitarisme. Quelle est la meilleure façon d’opérer les clarifications souhaitables et de mettre au pied du mur tous ceux qui refusent la tyrannie et le« taghoutisme » ? Quel meilleur barrage dresser contre le totalitarisme de quelque nature qu’il soit et le déferlement des haines ? Comment faire converger vers les mêmes objectifs salvateurs, la sincérité de la foi religieuse et des convictions démocratiques de tous ceux qui, ces dernières années, que ce soit dans les affrontements armés ou les manifestations pacifiques, se sont dit au service de choix concrets de libertés politiques et de justice sociale ?
Chacun dans son langage et son mode de pensée appelle ses concitoyens à « promouvoir le bien et se détourner du mal ».
Parviendront-ils dans les faits à mobiliser, par-delà les frontières d’exclusion idéologique, tous ceux qui souhaitent pour l’immédiat :
- la paix civile, le refus de la violence comme moyen de règlement des problèmes,
- le respect de tous les droits de l’Homme et du citoyen et des libertés démocratiques élémentaires,
- la recherche de solutions politiques, de mécanismes consensuels de transition et d’un climat culturel de tolérance.
Quels que soient les développements des semaines et mois à venir, tout laisse à penser que ce sera une œuvre difficile de longue haleine.
Mais c’est une œuvre vitale. Seules la destruction et la haine sont faciles.
Article paru dans El Watan le 14 juillet 1994